L’employeur a l’obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés, y compris lorsque ceux–ci sont cadres ou disposent d’une large autonomie dans l’exécution de leurs fonctions. Même les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent exercer une durée « raisonnable » de travail.
Rares sont toutefois les restrictions applicables au mode de contrôle mis en oeuvre par l’entreprise, et seuls les plus intrusifs peuvent être limités : géolocalisation, télétravail, mouchard numérique etc. Cette souplesse conduit le Juge à la sévérité, lorsqu’il s’agit de trancher un litige relatif à la durée de travail.
Le Législateur, en effet, répartit la charge de la preuve des heures de travail réalisées, conjointement entre l’employeur et le salarié. Mais si le salarié, demandeur, doit naturellement appuyer ses demandes sur des éléments probants, la chronologie induite par l’article L.3171-4 du Code du travail impose en tout état de cause à l’employeur de justifier de la durée de travail de son adversaire.
Ainsi même si le salarié ne fournit aucun justificatif au soutien de ses prétentions relatives au décompte d’heures supplémentaires, son employeur doit quant à lui verser aux débats la mesure objective de sa durée de travail. Bien sûr, on imagine mal, en pratique, une demande judiciaire qui ne reposerait pas sur un quelconque élément concret.
Mais sur ce point la jurisprudence admet un simple décompte manuscrit, réalisé par le salarié pour les besoins du procès et postérieurement à la période d’emploi. Par ailleurs à quelques exceptions près (par exemple pour les entreprises soumises au Code rural et de la pêche maritime), l’employeur est libre quant au mode de contrôle de la durée de travail (auto-contrôle validé a posteriori, par exemple) : mais il devra de toute façon justifier de ce contrôle.
Le Juge appréciera souverainement l’ensemble des éléments probants ainsi versés aux débats, pour admettre ou rejeter les demandes du salarié. Bien évidemment, le seul décompte établi par le salarié (qui s’il est rédigé postérieurement à la relation de travail, est d’ailleurs difficilement distingué de sa réclamation en elle-même…) n’aura qu’une faible force probante, dès lors que son employeur produira quant à lui plusieurs justificatifs contraires.
Mais le Juge ne peux rejeter les éléments produits par le salarié, comme insuffisamment probants, si l’employeur n’a pas lui-même justifié objectivement de la durée de travail de l’intéressé. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-16.397, inédit)
Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-16.397 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Santé famille 47, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d’infirmière coordinatrice par l’association Santé famille 47 le 5 septembre 2011. Elle exerçait en dernier lieu la fonction de directrice d’association.
2. Elle a été licenciée le 23 août 2019.
3. Le 31 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé, alors : « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l’employeur est tenu de leur fournir ; qu’en retenant, pour débouter Mme [H], qu’elle ne produisait aucune pièce corroborant sa demande quand il ressortait de ses propres constatations qu’elle avait communiqué des courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir, sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs, la description de ses tâches, des attestations de collègues confirmant sa charge de travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a d’ores et déjà violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que la salariée produit à l’appui de sa demande sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs, la description de ses tâches, plusieurs attestations de collègues confirmant sa charge de travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, des courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir et qu’elle ne produit aucun relevé des heures travaillées, aucun décompte des heures accomplies et de la somme réclamée, ni aucune pièce corroborant sa demande.
9. Il ajoute que la salariée présente un montant global et forfaitaire de 9 heures par jour sur cinq jours sans en justifier, alors qu’un tel calcul est proscrit par la Cour de cassation, que conformément à son statut, elle avait droit à quatorze jours ouvrés en plus des cinq semaines de congés payés, que les courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir ne prouvent pas l’amplitude horaire de travail dans la mesure où le salarié peut vaquer, avant ou après, à ses occupations personnelles, qu’elle disposait d’un jour de télétravail depuis le mois de septembre 2017, que le contrôle du temps de travail des salariés entrait dans ses attributions et que les attestations produites par la salariée faisant éloge de son investissement et de sa présence sur le site ne sont pas de nature à remplacer le décompte qui fait défaut.
10. En statuant ainsi, alors que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
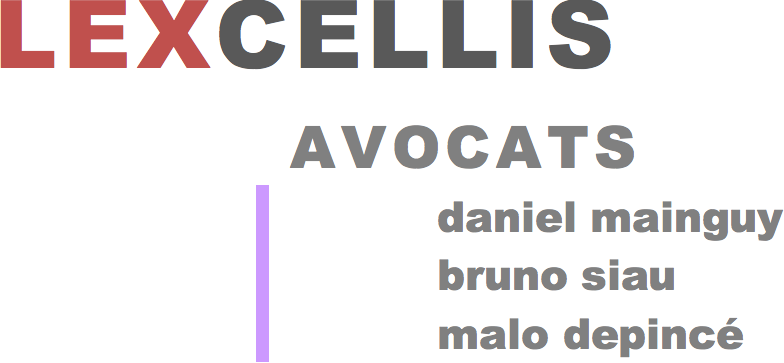
Commentaires récents